 |
 |
|
 |
 |
ZONE INDUSTRIELLE - Critiques + Extrait
Dans "ZONE INDUSTRIELLE", Limonov raconte sa vie à partir de 2003, à sa sortie de prison. A 60 ans,
protégé par ses gardes du corps pour éviter attentats ou empoisonnements, il poursuit ses dangereuses activités politiques. Il vit dans un ancien quartier ouvrier,
une zone industrielle dont il raconte la progressive gentrification, parfaite image d'un centre-ville de plus en plus hostile aux pauvres, obligés de s'exiler dans les lointaines banlieues de Moscou (à l'exemple des villes occidentales,
mais de façon encore plus sauvage et ultra-libérale). Dans "ZONE INDUSTRIELLE", Limonov parle aussi du Faust de Goethe, qui lui ressemble
par certains côtés, d'un demi-frère miraculeusement apparu ou d'une étonnante boite-restaurant du quartier fréquentée par de dangereux personnages. Il y
a aussi la rencontre avec la célèbre actrice Ekaterina Volkova, qui lui
donnera deux enfants et l'abandonnera très vite, ou encore la strip-teaseuse et comédienne
Magdalena Kurapina, au caractère bien trempé. On découvre dans "ZONE INDUSTRIELLE" un amoureux frénétique à
soixante ans passés, et aussi courageux qu'intraitable dans ses activités politico-littéraires. On comprend pourquoi Édouard Limonov est devenu l'un des hommes les plus
admirés de Russie (et aussi haï par les libéraux).
Le parti national bolchévique d'Edouard Limonov était très actif au début des années 2000, jusqu'à sa dissolution en 2007 (remplacé aujourd'hui par le parti "L'Autre
Russie", toujours dirigé par Limonov). Les actions spectaculaires et non-violentes du PNB (occupation de ministères, lancements d'oeufs contre des personnalités corrompues)
faisaient souvent la une de l'actualité. Avant son assassinat, la journaliste Anna Politkovskaïa avait salué le courage des jeunes militants nationaux-bolchéviques.
La répression était féroce : des années de prison pour des militants non-violents, comme en 2005 lors du "Procès des 39". VIDÉO
VIDEO du "Procès des 39" en 2005. On y voit les jeunes militants nationaux-bolchéviques dans des cages, et une interview de Limonov en anglais.
----- ----- ----- ----- -----
Critiques du roman "ZONE INDUSTRIELLE"
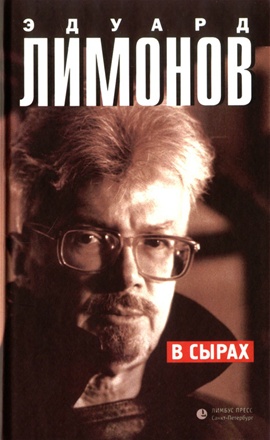 DANS LA ZONE
DANS LA ZONE
En 2012, au moment de la sortie en Russie du nouveau livre d'Edouard Limonov, В Сырах ("Zona industriale" dans la traduction italienne), le critique littéraire Dmitri Olchansky rappelle que le célèbre auteur russe… est aussi un simple mortel.
Nous sommes en 2003 au début du livre. Edouard Limonov vient de sortir de prison, après y avoir passé 2 ans et demi, pour trafic d'armes
et tentative de coup d'Etat au Kazakhstan. Par Dmitri Olchansky (L'un des critiques littéraires les plus célèbres de
Russie) Edouard nous raconte dans ZONE INDUSTRIELLE qu'il vit derrière la gare de Koursk, dans un misérable immeuble ouvrier des années 20, où la douche est dans la cuisine, le plafond fuit et le sol est en lino à fleurs. Il loue son appartement
alors qu’il vient lui-même de sortir de prison. Sans famille, sans argent et, évidemment, sans la moindre possession, il est un animal solitaire – comme disait de lui-même cet autre Edouard, l’émigré, qui, comme chacun
sait, mangeait du chtchi sur le balcon d’un hôtel new-yorkais. ( cf "Le Poète russe préfère les grands nègres" ) Cet Edouard-là avait la trentaine facile, alors que celui-ci a soixante ans passés :
vous sentez la différence ? Je suspecte que vous la sentez ; oui et puis la zone industrielle située derrière la gare de Koursk, ce n’est, hélas, pas Manhattan. Edouard est assis à sa table et regarde
par la fenêtre. Sous sa fenêtre, une aire de jeux pour enfants où sortent luncher les clercs – les charançons plats, comme il les appelle. Lui, s’il sort, ce n’est
que sous la protection de gardes du corps. Sur son palier, jour et nuit, des gardes veillent. Le parti radical qu’il dirige accumule les condamnations, les coups de matraques et les poursuites éprouvantes dans les rues – c’est bien la gare de
Koursk et pas Manhattan. Moins il y a de membres du parti, plus il y a de charançons. Chez Edouard, on croise aussi des filles. Mais l’une d’elles l’énerve, traînant obstinément derrière elle son bull-terrier,
les parents d’une autre – elle a dix-huit ans et lui soixante-cinq, vous sentez la différence ? – viennent la chercher alors qu’il se cachait d’une troisième, strip-teaseuse hystérique, en s’enfermant
à double tour dans l’autre pièce. Et quand il finit par se marier avec une belle actrice – il s’avère très rapidement que sa femme a cessé de l’aimer. Elle ne l’aime plus et s’est mise à
lui préférer Goa, en Inde, où l’on entre en « harmonie avec le Cosmos ». Tristesse et solitude Quand il s’endort, Edouard se couvre d’une vieille couverture de chameau, que sa mère lui a un jour envoyée. Sur la couverture sont tissées quatre cigognes, une
à chaque coin. Les cigognes sont là mais pas sa mère : « le corps de la vieille, de ma mère, a disparu dans les coulisses du crématorium », déclare Edouard, impitoyablement, comme ça, en
passant. Et
quelles autres paroles pouvez-vous attendre d’un tel homme ? Sur l’harmonie de sa mère avec le cosmos ? Ne perdez pas votre temps. Et pourtant Edouard se sent parfois triste et seul. À ce point seul qu’il est attiré par les ampoules vacillantes de la cour intérieure du boui-boui
du coin (où jamais il ne peut aller car il lui est en effet impossible de sortir sans gardes du corps) et que le rat vivant dans sa cuisine est devenu son meilleur ami. Mais le rat vieillit, tombe malade et meurt. Il le dépose alors dans un carton
avec du coton et envoie ses gardes enterrer son ami sur la berge de la Iaouza. Et ensuite, des commissaires arrivent chez Edouard. Ils ont un ordre de saisie et dressent l’inventaire de ses affaires : un chauffage à essence, une machine
à écrire Lyubava, un fauteuil de travail, un couteau de couleur noire. Et encore quelques livres. Et puis c’est tout. Edouard n’a rien de plus. Que nous réserve l’avenir ? C’est là qu’il est temps de poser une question banale et d’obtenir
une réponse banale. Que reste-t-il donc à venir ? La vieillesse et la mort ! De quoi donc, à proprement parler, est fait l’avenir ? Car finalement il n’y rien, rien que les cigognes sur la couverture, les gardes
sur le palier, le lino à fleurs et, finalement, les coulisses du crématorium. C’est quand tu as la trentaine facile que, où que tu sois, tout pour toi ressemble à Manhattan. Mais la soixantaine passée, c’est de plus
en plus la gare de Koursk. Vous sentez la différence, là ? Mais
Edouard – vu que son créateur, Limonov, est un écrivain non seulement excellent, mais chrétien, oui, chrétien, je ne me suis pas trompé –, cette différence, il ne la sentira jamais. Il ne la sentira pas,
parce que les livres de Limonov, tous jusqu’au dernier, sont consacrés à la bataille contre un péché mortel, pénible surtout pour les gens complexes, instruits, que ce péché écrase littéralement,
transforme en charançons plats, même si, du reste, il n’épargne pas non plus les gens simples. Ainsi donc, tous les livres de Limonov enseignent une seule chose : la lutte contre l’abattement. Il n’y a pas de zone industrielle
pourrie. Pas de gare de Koursk. Pas de plafond qui fuit. Pas de lino, pas de rat et pas de gardes sous la fenêtre. Pas de boui-boui ni de strip-teaseuse, pas de cigogne sur la vieille couverture offerte par la mère, pas même de mère
ni de femme, pas d’harmonie avec le cosmos et pas non plus de parti radical. Il n’y a pas plus d’âge que de différences – trente ou soixante. La saisie opérée par les commissaires est inévitable pour n’importe
quel mortel, rien n’en préserve ni n’en sauve : tôt ou tard, ils viendront et emporteront tout, et le chauffage à essence, et la machine à écrire Lyubava, et les
livres et le fauteuil de travail, et même le couteau de couleur noire. Mais si l’on fait comme Edouard et que jamais, en aucun cas, on ne cède à l’abattement, alors un jour, finalement, quand toutes les réponses
banales auront été obtenues et qu’il n’y aura déjà sans nul doute plus rien à attendre, alors apparaîtra pourtant ce qui était passé au travers de l’ordre de saisie des commissaires,
ce à quoi Edouard est condamné et que chacun, à son tour, voudrait effleurer : l’immortalité.
Dmitri Olchansky http://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Vitrorovitch_Olchansky
Traduit par Julia Breen dans le Courrier de Russie - 10 avril 2012 http://www.lecourrierderussie.com/2012/04/edouard-limonov-simple-mortel/#.UJEYxW9LOsE
***** "ZONE INDUSTRIELLE" Le livre est publié
sous le titre de ZONA INDUSTRIALE en Italie, en mai 2018. A cette occasion, Limonov est sorti de Russie pour la première fois depuis 23 ans. Il a effectué une
tournée triomphale en Italie en mai 2018.
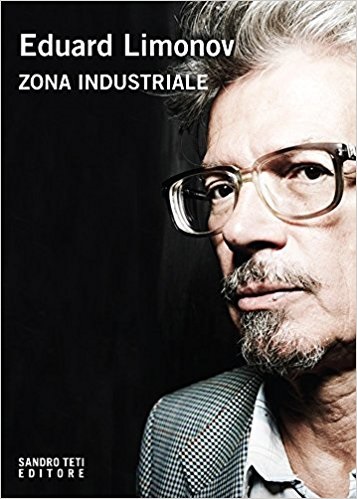 LA TRADUCTION DU LIVRE EN ITALIEN EST SORTIE EN MAI 2018.
LA TRADUCTION DU LIVRE EN ITALIEN EST SORTIE EN MAI 2018.
ZONA INDUSTRIALE a reçu d'excellentes critiques en Italie. En voici une
qui donne une bonne idée du livre. Par LUCA BAGATIN
« Zone industrielle », que l'auteur appelle "roman moderne", commence à sa sortie de prison, où il a passé deux ans et demi, accusé de trafic d'armes et tentative
de coup d'Etat au Kazakhstan. Le livre se situe entre 2003 et 2007, principalement dans la banlieue industrielle
moscovite de Syry, où Limonov va vivre dans un appartement délabré, loué par deux de ses amis. Limonov est toujours accompagné de ses gardes
du corps, ses fidèles nazbols, aussi soutenus par la regrettée journaliste Anna Politkovskaïa, nazbols qui sont devenus célèbres et persécutés en Russie pour leurs actions symboliques de protestation contre
le gouvernement de Poutine. Ils lancent des œufs et des tomates aux autorités, ils occupent des ministères, rappelant de plusieurs manières les exploits goliardiques des légionnaires de Rome fidèles à Gabriele
d'Annunzio. En quittant la prison, Limonov est attendu par sa fidèle compagne, la punkette Nastya
agée de 20 ans, une militante nationale-bolchévique beaucoup plus jeune que lui et qu'il surnomme « enfant bulterrienne » car elle est toujours accompagnée de son énorme chien bull-terrier, qui ira qui vit avec eux dans
l'appartement de Syry, au moins jusqu'à ce que les malentendus entre Limonov et Nastia leur feront prendre des chemins différents. Nastya donnera à Limonov un beau rat femelle blanc, qu'il nommera Krys et auquel sont consacrées des pages très belles et très émouvantes dans "Zone Industrielle".
La relation entre le soi-disant "cynique " et "dur " Limonov et Krys est vraiment très tendre. Krys aime le savon à lessive et sent comme ça. Il aime sauter sur les
jambes et les épaules et courir dans l'appartement. Malheureusement, Limonov apprend que les souris, malgré ou tout aussi vives et énergiques, ne vivent quelques années. Quand il voit son Krys s'affaiblir, il devient triste
et n'accepte pas son vieillissement, et quand Krys meurt le 10 mars 2005, Limonov construit un cercueil avec une boîte, mettant de la ouate comme oreiller à l'intérieur et une guirlande autour du petit cercueil.
Et le rat Krys est enterré par ses gardes du corps dans la cavité d'un arbre. Il l'aimait vraiment.
Limonov se décrit comme un cynique, mais en réalité, il est un homme qui aime. Et il adorait ses nombreuses
femmes, toutes plus jeunes que lui, souvent "mauvaises filles", des filles alternatives parfois punk, un peu comme lui, qui étaient ses épouses et ses amantes. Si proche que soit la relation entre lui et l'autre sexe a été
plutôt orageuse. Dans "Zona Industriale", l'auteur décrit sa relation avec l'actrice, la
femme qui lui donnera deux beaux enfants: Bogdan et Aleksandra. L'actrice est sa dernière femme en date, et il décrit leurs rapports comme ceux d'un «chaman» avec sa «Vénus». Relation passionnée
mais aussi orageuse, faite de malentendus, qui a duré quelques années. Années
pendant lesquelles Limonov fait de la politique, avec Kasparov et Kassianov, organise une coalition anti-gouvernementale - L'Autre Russie - composée de nationaux-bolchéviques , libéraux, communistes et nationalistes, qui finalement échouera
à cause des querelles internes de la composante libérale. Dans le livre Limonov exalte,
entre autres, le sexe, compris non pas dans sa fonction de reproduction, mais de « love making », il parle de sa théorie du «dépassement de la solitude cosmique », c'est à dire la solitude humaine - qui menace de
flétrir l ' être humain - et qui ne peut être surmonté que par le sexe, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, c'est à dire en rejoignant un autre être humain, également perdu dans la solitude cosmique.
En ce sens Eduard Limonov s'affirme comme un digne héritier et compagnon érotique de Casanova et d'Annunzio précité.
Certains chapitres de « Zone industrielle »
sont dédiés aux réflexions spirituelles et métaphysiques, interprétations personnelles de la Bible, les interprétations autour de l'univers féminin, un grand mystère qui a toujours fasciné Limonov
et avec qui il a toujours été une relation duale, d'amour et de conflit, même avec sa mère âgée qui lui reproche au téléphone affectueusement de ne pas avoir toujours "la tête sur les épaules"
et lui demande d'arrêter "ses bizarreries". Eduard Limonov
ne s'est jamais enrichi avec ses activités. C'est un éternel jeune homme de 75 ans. UN dissident intégral. Un hérétique érotique avec ses lunettes, sa barbiche, ses cheveux rasés sur les côtés et
derrière dans le style post-punk. Un personnage nouveau. Un cynique au coeur tendre qui a fasciné et continuera à fasciner des générations de jeunes idéalistes et radicaux de l'Est et de l'Ouest de la planète
Terre, qui se battent pour les plus faibles.
Luca Bagatin *****
Le début de "ZONE INDUSTRIELLE" Après ma sortie du camp, je me suis installé dans un grand appartement inoccupé, rue Nijnaya Syromiatnitcheskaya, dans une zone industrielle située derrière la gare de Koursk. Il y a un immeuble de six étages
à côté de l’usine du Manomètre. C’était alors le seul immeuble d’habitation dans cette zone délimitée d’un côté par la rivière Yaouza et de l’autre par les voies
ferrées partant de la gare de Koursk, et construites en hauteur, sur des ponts. Il était occupé par de drôles de gens. Le musicien Gera Morales, le leader du groupe Jah Divizion, aux cheveux déjà grisonnants, y promenait
son chien. Pendant ses concerts, le dessin d’une feuille de marijuana était suspendu au-dessus de la scène, bon, vous avez tout compris… et en dessous de chez moi, au rez-de-chaussée, vivait un commandant de police…
Cet ensemble avec ses tunnels, ses bâtiments d’usines désaffectées, avec des terrains vagues de l’autre rive de la Yaouza, cet endroit que les gens appelaient communément
Syry, avait un côté mystique. On pouvait pendant des journées entières, je vous le jure, y tourner des films d’horreur, d’après les scenarii d’Hanns Heinz Ewers ou de Lovecraft ! Un matin, de bonne heure,
une fille qui sortait de chez moi s’est fait mordre par une meute de chiens et, une autre fois, un couple qui venait me voir a aperçu une bande de types en train de massacrer une voiture avec des battes de baseball. Dans la ruelle Syromiatnitcheskaya
n° 4, juste à l’endroit où se trouve maintenant l’entrée du centre d’art contemporain Vinzavod, des tas de prostituées faisaient le tapin toute la nuit. On les amenait jusqu’ici dans deux minibus, les
pauvres filles. Bon, vous avez compris quel genre d’endroit c’était…
Comment je me suis retrouvé là ? J’avais succédé, dans cet appartement,
au directeur des éditions « Ad Marginem », Micha Kotomine (en fait, il appartenait à une femme d’un certain âge, autrefois serveuse, mariée à un plombier). À ma sortie de prison, il ne me restait absolument
plus rien. J’ai débarqué juste avec un petit balluchon et un sac des postes françaises et je me suis installé là. Des gardes du corps venaient me chercher et me reconduire dans une Lada 5 rouge. En tant que leader du
parti radical, qui n’était pas encore interdit à l’époque, je me pliais scrupuleusement à cette discipline. J’évitais tout contact quand mes voisins essayaient de lier connaissance. J’avais coupé
le fil de la sonnette électrique, je ne répondais pas quand on tapait à la porte.
Six mois plus tard à peu près, les habitants ont fait installer un digicode
que j’ai commencé à utiliser, mais de façon très sélective, je ne répondais que lorsque j’attendais une visite. La copine qui m’avait accueilli à ma sortie de prison avait perdu l’habitude
de vivre avec moi et, peu à peu, elle s’était éloignée de moi. Habituellement, si je n’étais pas invité quelque part, je passais mes soirées avec le rat blanc qu’elle m’avait laissé
quand elle était retournée vivre chez ses parents.
L’animal répondait au nom de Ra et c’était un compagnon idéal, il m’amusait et il embellissait
ma vie. Bien sûr, j’avais songé qu’il fallait que je me trouve une autre copine, mais ce n’était pas une entreprise aisée pour quelqu’un qui est constamment entouré de ses agents de sécurité,
qui ne peut pas s’éloigner de son domicile sans eux. En plus, ce genre d’opération demande de l’énergie. J’ai néanmoins fait preuve d’obstination, j’ai eu plusieurs petites amies, mais quand on
sort de détention et qu’on a soixante ans, c’est difficile de trouver chaussure à son pied.
Un jour, c’était au printemps, j’étais rentré
d’une soirée extrêmement barbante, organisée par un journal allemand en l’honneur de la prise de fonction du nouveau rédacteur en chef. Je n’avais rien à y faire, les gens qui y assistaient étaient
principalement des fonctionnaires russes et des journalistes plus ou moins officiels, et il n’y avait pas du tout de jeunettes. Rien que des matrones rondouillardes. C’est pourquoi je me suis rabattu sur l’alcool, j’ai bu un peu plus
que d’habitude. Donc, j’étais un peu éméché et plutôt exacerbé quand mes gardes m’ont reconduit : ces jeunes gens, ils parlaient de façon animée, m’ont déposé chez
moi pour aller ensuite rejoindre leurs copines, et peut-être, aller enfin boire un coup… hé, je ne suis pas le seul… J’ai fermé ma porte à clef derrière eux (je n’avais alors qu’une seule porte,
c’est par la suite que j’en ai fait installer une deuxième) et je suis allé dans la cuisine où la cage du rat trônait entre l’antique baignoire sur pieds et la gazinière. Ra, tout heureux, se balançait
sur les barreaux de sa cage, il sentait qu’il allait être libéré. Il savait que j’allais le laisser sortir pour effectuer son rituel quotidien; après un joyeux périple le long de mes jambes de pantalon, puis le
long de ma chemise — pour arriver sur mon épaule —, il est redescendu par terre, a fait le tour du propriétaire et, en passant dans chaque pièce et dans le couloir, il a arpenté les soixante-deux mètres carrés
de l’appartement…
On frappa à la porte.
Ra avait déjà
sauté de la cage que je venais d’entrouvrir, il était en train d’escalader les jambes de mon jean. Je ne suis pas allé ouvrir, je n’ai même pas fait un mouvement en direction de la porte. Les flics ont une autre
façon de taper à la porte, une façon insolente, qu’on ne peut pas confondre avec celle dont la voisine, qui vient quémander du sel, toque à la porte. Ceci dit, il y a bien longtemps que je n’ai plus de voisines
qui viennent me déranger. Elles ont peur d’avoir affaire à…
On frappa de nouveau. Le « toc-toc » avait une certaine retenue, ce n’était
pas celui d’un flic. Je pouvais y aller. Mais j’avais l’interdiction absolue d’ouvrir la porte si j’étais seul dans l’appartement. Je suis allé dans la salle à manger avec mon rat sur l’épaule,
j’ai tiré les doubles rideaux et allumé la télévision. Schwarzenegger d’un pas métallique et pesant avançait dans le couloir d’un souterrain et mettait en joue, avec son fusil infrarouge, un ancien
policier, reconverti en truand. Et dehors, à une bonne dizaine de mètres de moi, dans le couloir, quelqu’un continuait à frapper plus doucement…
Le bruit cessa.
Ra se promenait joyeusement (la queue parallèle au sol) le long du mur de la salle à manger vide. Je m’étais assis sur mon lit king size qui se trouvait au milieu de la pièce, et je regardais Schwartzy à
moitié couvert de brûlures. Soudain, j’entendis du bruit à la fenêtre, manifestement, quelqu’un avait lancé un caillou sur la vitre, ou peut-être qu’on tirait avec une carabine à air comprimé.
Non, c’était bien un petit caillou… puis un autre. J’ai poussé un soupir et je me suis levé. Il se passait quelque chose de bizarre.
Je suis passé
discrètement dans mon bureau (où il n’y avait rien de particulier comme mobilier, si ce n’est une table et des étagères) et, sans allumer la lumière, j’ai légèrement soulevé le rideau.
J’ai jeté un coup d’œil dehors. Un homme seul se tenait en bas, sous les arbres dénudés. La grosse lampe au-dessus de l’entrée me permettait de voir qu’il s’agissait d’un gars d’un
certain âge, avec une veste sombre et une casquette. Était-ce un admirateur de mon talent littéraire ? Un illuminé qui cherchait à disserter sur la façon de sauver l’humanité avec un VIP ? Ou bien le père
d’un natsbol, militant du parti bolchevik national, venu me casser la figure, parce que son fils s’est retrouvé en prison ? Aucune de ces suppositions ne me convenait. Ce qui m’inquiétait surtout, c’était l’heure.
Il était presque minuit, mais pas tout à fait.
Ayant galopé tout son soûl, Ra est venu me retrouver dans la pièce obscure et il a grimpé sur mon épaule,
sa place favorite. On ne lançait plus de cailloux. Il s’était mis à pleuvoir et on entendait la pluie tambouriner sur les appuis de fenêtre en aluminium…
On
frappa de nouveau… Je me suis dirigé vers la porte, avec Ra sur l’épaule.
— Qui est là ? Qu’est-ce que vous voulez ?
— Édouard, je suis de votre famille. Pardonnez-moi de venir si tard. Je peux entrer ?
Je n’ai pas beaucoup de famille, mais ça arrive que des
parents viennent me voir. La fille d’une de mes cousines vit à Magadan. Elle est vétérinaire. Elle a même soigné un jour le chien de Tsvetkov, le gouverneur qui, par la suite, s’est fait tuer sur l’Arbat,
à Moscou.
— Quel est votre nom ?
— Je m’appelle Youri. Je suis le fils de votre père.
J’ai ouvert la porte fermée à double tour, j’ai fait glisser la targette, tout en réfléchissant à ce que l’homme venait de me dire. Et il venait ni plus ni
moins de me dire qu’il était mon frère. Chez nous, moi, j’étais fils unique.
— Je vous en prie, excusez-moi de débarquer en pleine nuit, si tard.
Mais, j’ai un train demain.
Il a retiré sa casquette, en fait, il était chauve, avec quelques touffes de cheveux gris juste au-dessus des oreilles et sur la nuque. Un visage
ridé, pâle. Je l’ai reconnu tout de suite : il assistait à la soirée organisée par le journal allemand. Il se tenait sur le côté et m’observait. Moi, par ailleurs, je suis habitué à ce
qu’on me regarde, dans la rue, il arrive même qu’on me montre du doigt ou que les gens se balancent un coup de coude dans les côtes, pour dire, tiens, vise un peu qui arrive…
— Vous venez d’où, Youri ? Pourquoi vous m’avez suivi ?
— Je viens de Glazov, en Oudmourtie. La ville de Glazov, ça ne vous dit rien ?
— Si. Entrez donc dans mon bureau.
J’allumai le plafonnier.
—
Enlevez donc votre veste. Asseyez-vous.
Il retira sa veste en jean, décorée d’une multitude de surpiqûres et de rivets. C’était le genre de veste qu’on
pouvait mettre aussi en hiver. Les provinciaux en raffolent. Sa veste était trempée. C’est intéressant, parce que la fille de ma cousine, elle aussi, portait toujours des vêtements en jean. Je me souviens de son manteau avec
des ramages et des pierres brodées sur le tissu. Elle est venue me voir plusieurs fois à Moscou, à l’occasion de congrès de vétérinaires.
Il s’installa
dans le fauteuil dont j’avais hérité de je ne sais plus quelle organisation politique. Et il sourit.
— Vous avez un rat, me dit-il.
— Et qu’est-ce que vous croyez… forcément, un gars comme moi a un rat. Comme ça, vous êtes le fils de Veniamine ?
Je pris l’autre
fauteuil, exactement identique au sien.
— Oui, mon nom est Youri Veniaminovitch.
— Vous m’en direz tant!…
Je croyais que c’était une pure légende dans la famille, le fruit de l’imagination de ma mère quand elle était jeune et jalouse. Le fantasme d’une rivale dans la taïga de la république des Mari.
— De la république d’Oudmourtie, rectifia-t-il.
— Maman parlait de la république des Mari, où il chassait
les déserteurs. Il avait un mandat, signé par Beria en personne.
— C’est vrai, mais c’était dans la taïga Oudmourte. C’était alors un
jeune lieutenant.
— Ma mère racontait qu’elle pensait l’avoir perdu à jamais à cette époque. Qu’il avait fondé une autre famille, dans
les neiges de la république des Mari, en 1943. Aussitôt après ma naissance.
— Oui, tout ça, c’est vrai, seulement, c’était dans les neiges
de la république d’Oudmourtie. Vous voulez que je vous raconte les événements dans l’ordre ? Et après, vous me raconterez ce que vous savez…
—
Vous raconter… Vous voulez du thé ?
— Non, merci. Bon, voilà, moi, j’ai un an de moins que vous, je suis de 1944. Il n’y a pas eu beaucoup de naissances
en Russie dans ces années-là. Il y a un creux d’une génération, il n’y avait pas assez de naissances parce que les hommes, pour la grande majorité, se trouvaient loin de chez eux, sur les différents fronts.
Il y avait des femmes au front, mais très peu, et c’était le genre de femmes qui n’étaient pas vraiment enclines à la procréation. Si notre père à tous les deux, Veniamine Ivanovitch, n’a pas
été envoyé au front, c’est en fonction d’un heureux concours de circonstances. Il a été appelé en 1937 et s’est retrouvé dans un bataillon spécial de l’OGPOU, puis, quasiment à
la veille de la guerre, il a rempilé.
Quand la guerre a éclaté, le NKVD n’a pas voulu laisser partir ses hommes et il les a gardés. Youra, le plus jeune frère
de notre père (c’est pour ça qu’on m’a appelé Youri) a été mobilisé dans la précipitation. Une précipitation sauvage. Les jeunes gens n’avaient même pas le temps de mettre
leur uniforme qu’ils étaient envoyés sur le front, à Pskov, c’est là que Youri est mort, on n’a jamais retrouvé son corps. Il a été porté disparu…
— Vous connaissez certainement tous les détails de la biographie de votre père aussi bien que moi.
— Oui.
— Votre père est arrivé à Glazov en 1943. Déserter était une chose courante à l’époque. Les gars se cachaient dans les forêts, ils se nourrissaient de bouillies, ils
se regroupaient en bandes et représentaient un certain danger pour la population locale. Ma mère dit qu’il était très beau. Et qu’est-ce qu’il jouait bien de la guitare !…
— Maintenant, il chie sur lui. Avant, maman le portait jusqu’aux toilettes, mais elle s’est abîmé la colonne vertébrale, alors maintenant, elle l’installe sur une chaise percée, avec
un seau en dessous. C’est là qu’il fait ses besoins, tout près de son lit… Le temps, il vous joue de drôles de tours… Il a quatre-vingt-six ans et ça va faire un an qu’il ne sort plus de son lit. Il
n’est pas malade. Il en a marre de la vie, c’est tout. Il a envie de mourir.
— Moi, je n’ai pas pu me décider à aller le voir, dit Youri, pour être
franc, le sens de la famille m’a pris il n’y a pas très longtemps. C’est venu avec l’âge. Apparemment, c’est ainsi que les hommes sont aujourd’hui.
— Moi, on ne m’a pas laissé entrer en Ukraine, l’année dernière, après que j’ai été libéré du camp. On m’a gardé en détention un moment dans un poste
de la police des frontières, appelé Goptivka, car on ne savait pas quoi faire de moi. Finalement, sur la base de je ne sais quels articles de leurs services de sécurité, l’équivalent du FSB chez nous, on m’a interdit
de me rendre en Ukraine jusqu’au 25 juin 2008. Si bien que, mon Dieu, je n’ai pas encore eu l’occasion de voir mon père dans l’état pitoyable où il se trouve. Comment s’appelle votre mère ?
— Sophie. Sophia.
— C’est un nom oudmourte ?
— Mais non,
c’est un nom normal, un nom russe. Mais elle est Oudmourte.
— Elle vit encore ?
— Oui. Elle habite avec nous,
chez moi. Elle est de 1921.
— De la même année que ma mère.
Nous nous tûmes un petit moment.
— Et vous avez des frères et soeurs, Youri ?
— Oui. Deux demi-frères. D’un autre père, mais il est mort.
Nous nous tûmes de nouveau.
— J’ai lu vos livres qui parlent de votre famille, comme La Grande Epoque et Autoportrait
d'un bandit dans son adolescence. Je n’aime pas la façon dont vous parlez de notre père dans la Grande Époque. Je les ai lus il y a relativement peu de temps. Je les ai donnés à lire à maman.
— Et alors, comment elle a réagi ?
— Elle est restée assise, en silence, en souriant… Ensuite, elle a reparlé
du jour d’hiver de 1943 où il était arrivé, jeune et très maigre, vêtu d’un long manteau. Ce sont des soldats de l’Armée rouge qui l’avaient conduit à destination, maman avait remarqué
sa guitare dans ses affaires. À vrai dire, il n’avait pas grand-chose. Un tout petit sac avec ses affaires, son paquetage de soldat, et son pistolet à la ceinture. La moitié de notre maison était inoccupée, alors, on
l’a installé chez nous pour qu’il ne loge pas à la caserne avec les autres. C’était un policier quand même. Un gars des services de sécurité. Avec un mandat.
— C’était, si j’ai bien compris, la maison de vos grands-parents ?
— C’est ça. Aujourd’hui encore, Glazov est une petite
ville de dix mille habitants, mais il y a soixante ans, c’était une toute petite bourgade de province engourdie. Avec des maisons particulières, en majorité. Mon grand-père possédait une maison à deux étages,
avec un rez-de-chaussée en brique. On a installé notre père en haut, dans l’ancienne chambre de mes oncles, ils avaient tous les trois été envoyés au front. Il y en a un qui avait déjà été
tué. Donc, notre père s’est installé dans sa chambre. Bon, maman racontait que, les premiers temps, il ne rentrait pas coucher la nuit. Il faisait des raids dans la taïga avec ses hommes. Ils ne sont revenus qu’au bout
d’une semaine. Puis, ils se sont occupés des procès des déserteurs. À l’époque, il est vrai, tout était plus simple. Les déserteurs étaient fusillés en vertu de la loi martiale. Dans
beaucoup de cas, les policiers étaient en même temps les juges. On appelait ça une commission collégiale militaire, je ne sais plus trop…
— Donc, notre
père travaillait là-bas comme policier ? Ou comme membre de cette troïka, de cette commission ?
— D’après maman, il était impliqué dans les
deux. Il exécutait les deux fonctions. Ou plus exactement, les trois.
— Qu’est-ce que vous entendez par là ?
— On manquait d’hommes. On n’allait pas perdre de temps à faire respecter la légalité, avec des déserteurs. On les collait contre le mur de l’ancienne laiterie. Pour les fusiller… C’était
les mêmes qui les jugeaient et qui exécutaient aussitôt la sentence.
Nous nous tûmes.
— Alors,
donc, mon père aussi en a collé au mur ?
— À en juger par vos écrits, cet épisode de la biographie de votre père ne doit pas vous surprendre…
Ma mère affirmait qu’il avait fusillé des déserteurs… ça le perturbait, car ces jeunes gens avaient en fait tous son âge, ou un peu moins. Il avait vingt-cinq ans. C’était des gars tout blonds. Le
peuple oudmourte fait partie de la famille des finno-ougriens. Il y a beaucoup de blonds parmi eux. Moi aussi, j’étais blond, avant que mes cheveux ne deviennent gris.
— Il
avait des angoisses, et comment ça se manifestait ?
— Eh bien, il avait du mal à dormir, il se réveillait souvent, il gémissait dans son sommeil. Ou il arpentait
sa chambre de long en large…
— Vous pensez que c’est plus dur de fusiller des blonds que des bruns ?
—
Oui, un petit blond, c’est un peu comme un gamin, il a quelque chose d’un enfant. On ne doit pas fusiller… des enfants… ça fait mal au cœur…
—
Pouvons-nous l’en blâmer pour ça ?
— À mon sens, oui… dit-il avant de s’arrêter. Et puis à quoi bon, toutes ces horreurs sont inscrites
pour l’éternité dansle Grand Livre du ciel. Dans le chapitre qui parle du mal.
— C’est quoi, ce Livre du ciel ? Un livre de croyances
traditionnelles oudmourtes ?
— Oui. Inmar, le dieu du ciel, est le gardien du Livre du ciel, et il le relit de temps en temps. Il le feuillette.
— Vous vous y connaissez dans ces croyances ?
— Oui, un peu. J’enseigne l’histoire. Et à titre personnel, je m’intéresse
aux croyances traditionnelles des Oudmourtes. Nous avons quarante dieux et déesses. Mon grand-père connaissait tout ce panthéon. Et mon arrière-grand-père était lui-même un vossias, c’est-à-dire
un grand prêtre. Veniamine traitait ma mère de petite « chamane » parce qu’elle vient d’une famille où il y avait quelques tuno et un grand prêtre. Un tuno, c’est un rebouteux,
un chaman.
— Vous n’auriez pas de photos de votre mère sur vous ?
Il hocha la tête, en répondant
:
— Si j’avais su que je vous rencontrerais, j’en aurais pris quelques-unes avec moi.
— Et la petite
chamane, qu’est-ce qu’elle faisait dans la vie ? Le jour où Veniamine est descendu de son traîneau dans son grand manteau, qu’est-ce qu’elle faisait ? Qu’elle était sa profession ? Elle avait vingt-deux ans…
— Elle était institutrice en primaire. Elle a commencé à travailler après ses études à l’École normale.
— Et à quoi elle ressemblait ?
— Elle portait une longue natte sur le côté, une grosse natte de cheveux blonds. On la remarque tout de suite sur toutes
les photos, sa natte. C’était une belle fille. Une blonde avec des cils épais, noirs. Et des yeux ! D’un bleu de glace.
— Ma mère aussi a les yeux bleu
gris. Et aujourd’hui encore, même avec l’âge, elle a gardé son regard perçant, comme celui d’une louve. C’est d’ailleurs comme ça qu’on l’appelait à la maison, à cause
de ses yeux… et les voisins aussi… Si je comprends bien, notre père était un homme à femmes ? Vous, qu’est-ce que vous en pensez, Youri ?
— Vous
devez le savoir mieux que moi, je ne l’ai pas connu. Moi, je suis un enfant naturel, hors mariage.
— À l’époque où j’ai commencé à
prendre conscience des choses, j’ai l’impression qu’il ne se laissait plus aller, comment dire, à ses penchants. Mais ma mère en souffrait, je m’en souviens bien. Parfois, la nuit, ils se chamaillaient. Ils ne se disputaient
pas vraiment, mais elle lui faisait des reproches et il répondait toujours par monosyllabes. En parlant de ça, moi aussi, je suis né hors mariage, mes parents ne se sont mariés qu’en 1951.
— Apparemment, c’était un homme à femmes. Avoir deux familles à vingt-cinq ans, ce n’est pas courant… Il a quand même passé un an chez nous, il vivait avec ma mère au
vu et au su de tous. Ce n’était pas facile pour elle. Lui, c’était un étranger, il avait débarqué chez nous pour attraper les nôtres dans les forêts, pour les juger et les fusiller. Parfois, toujours
d’après ma mère, il se produisait des scènes à fendre le cœur. Un jour, la mère d’un déserteur a débarqué chez nous, je ne sais pas comment elle avait appris où il habitait, elle
a attendu qu’il rentre et s’est jetée à ses pieds… Elle s’est mise à l’implorer en hurlant : « Épargne mon fils, mon enfant ! Toi-même, tu es tout frêle, encore un enfant, ne tue
pas mon petit… »
— Et qu’est-ce qu’il a fait ?
— Que voulez-vous qu’il fasse ? Il
ne pouvait pas l’épargner, de toute façon, il n’aurait pas été autorisé à le faire. Il n’était pas le chef dans cette troïka, il y avait aussi un capitaine du NKVD local qui était
plus gradé. Il l’a aidée à se relever et lui a dit : « Partez, sinon, vous allez, vous aussi, être arrêtée. »
—
Et le mandat, signé par Beria ?
— Ce mandat avait son importance, mais c’est la troïka qui décidait de tout. Et cette année-là, le verdict, c’était
l’exécution, c’est tout. En plus, le gamin dont la mère était venue implorer notre père avait été capturé suite à une attaque contre les déserteurs : ils avaient défendu leur
planque, ils avaient tiré. Comment peut-on imaginer leur laisser la vie sauve?… Après ce combat, notre père a reçu sa première décoration, celle de l’ordre de l’Étoile rouge…
— Il a en reçu une autre ? Moi, je n’en connais qu’une.
— Oui. À la fin de l’année, il a été
décoré une deuxième fois. À quelle occasion exactement, je n’en sais rien. Mais, c’était probablement toujours dans le cadre de la lutte contre les déserteurs. Parce qu’il séjournait encore
à Glazov et qu’en Oudmourtie, il n’avait pas d’autre activité que de poursuivre les déserteurs.
— Donc, il a dû être décoré
pour avoir investi une deuxième planque…
La pluie tambourinait inlassablement, car il y avait un redoux assez brutal, comme il peut y en avoir en mars à Moscou. Nous étions
là, tous les deux, deux hommes aux cheveux gris, à blâmer les agissements de notre père quand il avait vingt-cinq ans, celui qui nous avait donné la vie à tous les deux, en répandant sa semence dans deux femmes
différentes.
— Vous vous représentez la situation, Youri, la taïga, les arbres noirs, la neige, il fait encore nuit. Les soldats de l’Armée rouge, vêtus
de grands manteaux militaires, se faufilent à la queue leu leu entre les arbres, dans les lueurs du petit matin. Ils s’approchent de la cachette des déserteurs. Un petit filet de fumée sort de la cheminée, la veille au soir,
les déserteurs ont copieusement chargé le feu pour qu’il fasse chaud toute la nuit dans la cabane. Ils sont encore couchés sous leurs vareuses fourrées, ce sont des gars au teint clair, avec des taches de rousseur, des paysans
finno-ougriens. Il n’y en a pas beaucoup avec des cheveux foncés. La cabane est devenue une vraie étuve. Le cordon de soldats se referme autour d’eux. Enfin, notre père (le pistolet à la main) ainsi que deux soldats
rouges, des hommes assez costauds, s’appuient de tout leur poids contre la porte de la cabane pour la défoncer. Ils pénètrent dans une pièce où il fait noir et étouffant. Ils sont accueillis par des tirs de fusil.
Un soldat rouge s’effondre. Notre père n’est même pas blessé. Les soldats traînent les déserteurs dans la neige : ceux-ci sont en sous-vêtements, certains portent le linge blanc de l’armée, d’autres
des chemises de paysans. Ils lèvent les mains en l’air. Il commence à faire jour. Ils sont debout, pieds nus dans la neige, tous grelottant de froid. Vous imaginez la scène, Youri ?
— Vous avez l’imagination d’un écrivain. J’en ai froid dans le dos.
Youri se mit à frissonner.
— L’imagination n’a rien à voir ici. Moi, j’ai été arrêté exactement de la même façon. Dans les montagnes de l’Altaï, dans la neige, dans une petite isba. Nous étions
huit. Au petit matin, il y avait de la brume. Il faisait très chaud à l’intérieur. L’un d’entre nous s’est levé pour aller se vidanger. Il était à moitié réveillé, mais
il a quand même repéré des tireurs qui s’approchaient en file indienne de notre abri, tout un bataillon de marche du FSB. Alors, il rentre précipitamment dans la cabane, en criant qu’il y a plein de soldats dans la forêt.
Il y en avait quand même un peu plus de soixante-dix.
Ils prennent la cabane d’assaut, en poussant des cris de sauvages. Ils jettent des ordres différents : « Couchés »,
« Au mur », « Les mains sur la tête », « À terre, putain ! », « Debout, putain ». C’est clair, il était impossible
d’exécuter tous ces ordres en même temps, alors, chacun est resté allongé à sa place. Ensuite, on nous a fait sortir un par un. Pieds nus. Celui qui avait gardé ses chaussettes pour dormir était un peu
plus chanceux, car on nous a laissés longtemps dans la neige, habillés comme on était, en maillots de corps et pieds nus. Les mains en l’air. Puis, on nous a permis de nous habiller et on nous a conduits dans le local pour les bains.
On est restés là à attendre encore un bon moment, puis les interrogatoires ont commencé.
— Vous aviez peur ?
— Oui. D’abord, nous nous sommes dit que c’était les services de sécurité du Kazakhstan, venus de l’autre côté de la frontière. Nous avons pensé qu’ils allaient tous nous
tuer dans la montagne, au fond d’un défilé. Que les ours, les loups, les oiseaux feraient le reste. Mais, c’était des Russes. En plus, ils ont pris une vidéo où on nous voit debout dans la neige, les mains derrière
la tête, en maillots de corps et pieds nus. Elle restera dans l’histoire. Donc, j’imagine très bien ce que les déserteurs ont pu ressentir quand mon père a fait irruption avec ses hommes dans leur cabane, au petit matin.
— En somme, c’est comme si, vous et votre père, vous vous étiez retrouvés chacun d’un côté de la barricade. Notre père a toujours été du
côté du gouvernement… et vous, vous vous êtes retrouvé dans la peau d’un déserteur.
— Oui, c’est comme ça. Mais dans les montagnes
de l’Altaï, on m’a arrêté, car on voulait m’inculper de préparer une tentative d’occupation et de séparation de la province orientale du Kazakhstan voisin. De vouloir former un état séparatiste
dans le but de l’annexer à la Russie. Ainsi, notre père, s’il s’était trouvé dans le bataillon du FSB ce matin-là, n’aurait pas été du côté de la Russie. Alors qu’en
1943, il était du bon côté… et en 2001, j’étais du côté de la Russie.
Nous nous tûmes.
— Vous prendrez peut-être un verre de vin ? Je n’ai pas de vodka…
— Non, je ne bois pas.
—
Comment ça ? Vous ne buvez pas du tout ? Même pour votre anniversaire ou pour la nouvelle année ? Vous ne fumez pas non plus, je suis sûr ?
— Je ne fume pas.
Un jour, j’ai bu deux petits verres, et ça m’a rendu malade.
— Vous êtes comme lui. Il n’a jamais bu ni fumé de toute sa vie. Les tchékistes
qui ne buvaient et ne fumaient pas étaient les plus féroces. Comme les ascètes de Kochtcheï.
— Je ne suis pas quelqu’un de méchant, dit Youri, en
souriant. Donc, il ne boit toujours pas ?
— Ma mère disait : « Celui qui boit reste couché, la tête vide comme une vieille noix. » Il a du
mal à parler. La semaine dernière au téléphone, ma mère m’a avoué qu’elle était horriblement fatiguée, qu’elle attendait qu’il meure. Qu’elle souffrait de le voir, lui, autrefois
si beau, si séduisant, de le voir étalé, impuissant, dans sa merde. Elle, cette femme qui a passé soixante-deux ans à ses côtés, attend aujourd’hui qu’il meure.
— Il a vécu une année avec ma mère, dit Youri.
— Comme la fin des héros du NKVD (ce qu’était notre petit papa) est
vraiment triste, laide et même terrible. C’est curieux, au fond, pourquoi a-t-il passé sous silence ses décorations de l’ordre de l’Étoile rouge ? Pourquoi n’osait-il pas dire qu’il ne les avait pas
gagnées au front ?
— Et pourquoi il n’a pas fait carrière dans l’armée ? D’après ce que je sais, il a passé presque une vingtaine d’années
en tant que lieutenant en chef et c’est seulement quand il a quitté l’armée qu’on lui a décerné le grade de capitaine, c’est ça ? Comment ça se fait ? C’était pourtant un type intelligent
?…
— Notre père ne s’est jamais étendu sur cette question, comme sur beaucoup d’autres encore. Je le soupçonne d’avoir appartenu, même
en tant que simple lieutenant, à un groupe de tchékistes qui a été liquidé, fusillé. Ce qui lui a valu la vie en définitive, c’est qu’il n’était qu’un simple exécutant.
Vous savez, Youri, quand des copies des manuscrits de Soljenitsyne ont commencé circuler, j’ai eu, je m’en souviens, une conversation sérieuse avec mon père, ça devait être en 1968. Je rentrais de Moscou où
j’avais passé une année, je me suis mis à étaler mes connaissances toutes fraîches sur le Goulag, sur les répressions des années trente. Et soudain, il m’a dit : « Je l’ai lu,
votre Soljenitsyne. Il ne sait rien du tout! Moi, des choses, j’ai en ai vu et, en comparaison, toutes les atrocités qu’il brandit ne sont que des balbutiements de nouveau-né. Moi, j’aurais parlé de… »
Et là, il s’est tu. Je ne l’ai plus jamais entendu aborder ce sujet. Je pense qu’il a participé à des opérations terrifiantes, bien plus noires que la chasse aux déserteurs dans la taïga oudmourte et
à leur élimination.
Nous nous tûmes. Comme si nous avions besoin d’une pause pour recharger nos batteries. Notre père nous avait totalement épuisés.
Nous étions assis, en silence. Le rat, perché sur mon épaule, écoutait attentivement ce silence.
— Dans l'Adolescent, il y a une scène où
vous…
— Si on se tutoyait, mon frère. Sinon, ça fait bizarre.
— Si tu veux, frère. Dans
l'Adolescent, il y a un passage où le héros, c’est-à-dire toi, tu vas accueillir ton père à la gare et puis tu le retrouves dans une petite impasse, tout près des voies ferrées, à l’écart
des autres, où il dirigeait un groupe de convoyeurs en train de transférer des prisonniers de leur wagon spécial dans un véhicule spécial. C’est la vérité ou tu as tout inventé ?
— C’est vrai. Dans les années cinquante, notre père servait dans les troupes de convoyeurs de prisonniers. Il partait en mission loin en Sibérie. On ne me disait pas où
il travaillait. Aux voisins non plus, d’ailleurs. Moi, j’étais tombé dessus par hasard. Je m’en souviens bien. J’ai instantanément éprouvé de la pitié pour les prisonniers. Peut-être ai-je
senti qu’un jour, je serais moi aussi à leur place ?
Il jeta un coup d’œil à sa montre.
—
Restez donc. Vous pouvez dormir ici. Le métro est fermé depuis longtemps et, dans le secteur, ce n’est pas facile de trouver un taxi.
— Ce n’est pas possible.
J’ai un ami qui m’attend dans la voiture. Nous sommes venus en voiture jusqu’ici.
— Donc, vous m’avez suivi après la soirée ?
— Oui, dit-il, sans oser me regarder.
— Ce n’est pas pour rien que vous êtes le fils d’un tchékiste !
— On se tutoie, n’oublie pas. Toi, aussi, tu es le fils d’un tchékiste.
— Comment tu savais que je participerais
à cette réception ?
— Il existe un réseau qui s’appelle Internet. Où il est écrit que tu étais attendu parmi les invités. Mikhaïl
m’a montré le message. Et on s’est mis en route. Ça n’a pas été difficile de rentrer.
— Mikhaïl, c’est ton copain ? Celui qui est
dans l’auto ?
— Oui. Ça fait vingt ans qu’il vit ici, à Moscou. Il est de Glazov.
— Appelle-le.
Pourquoi il attend dans le noir, dans l’auto !
— Non, ce n’est pas la peine, on va y aller. J’ai un train demain matin.
Il se leva.
— Bon, comme vous voulez, Youri.
Je me suis levé moi aussi.
Je lui ai donné une carte de visite (je venais juste d’en faire imprimer) sur laquelle étaient laconiquement inscrits mon nom, mon prénom et mon numéro de portable. Lui, s’est approché
de mon bureau et il a noté son numéro personnel à Glazov. Le rat était sur le bureau. Youri lui a dit, en souriant :
— Au revoir, le rat !
Le rat qui avait compris lui a adressé de petits piaillements. Et il s’est gentiment dressé sur ses pattes arrière.
Youri
a enfilé sa veste. Nous nous sommes dirigés vers la porte, je le précédais. J’ai ouvert les deux verrous, il a franchi le seuil et s’est retourné.
—
Édouard, vous l’aimez ?
— Si j’aime mon père ? Oui, j’aime mon père, même s’il s’est conduit comme les catholiques qui ont tué
des huguenots la nuit de la Saint-Barthélemy. Mais c’est mon père, il reste le jeune gars qui m’a donné la vie, par amour pour une jeune fille. Qui vous a donné la vie par amour pour une petite chamane.
— Comment votre mère appelait-elle votre père ?
— Venitchka.
— Ma mère aussi.
Notre père est mort fin mars. Une semaine après la visite nocturne que mon frère m’avait rendue. Youri n’est plus
jamais revenu, il n’a jamais téléphoné. Mon frère est peut-être mort, lui aussi. Car on meurt tous. Sans exception.
Ce texte figure dans le livre : NOSTALGIA - La mélancolie du futur
- Recueil de nouvelles russes. (avec également des nouvelles de Zakhar Prilepine, Vladimir Sorokine, Mikhaïl Chichkine,
Elena Pasternak, etc...) Paru chez Louison Editions - Daphnis et Chloé en 2015 http://www.louison-editions.com/
|
|
 |
|
|
|